L’association Diversités (blog) organisait la semaine dernière un atelier pour favoriser la coopération entre la France et les pays en développement sur la question du livre numérique. Diversités est une association qui a pour but de favoriser les échanges dans le domaine des industries culturelles, financée par le ministère des Affaires étrangères pour faire la promotion de la France à l’international et faciliter les relations entre les acteurs des industries culturelles françaises et leurs homologues étrangers.
Un atelier qui m’a donné l’occasion d’écouter et de rencontrer plusieurs éditeurs méditerranéens, dont l’écrivain et éditeur Sofiane Hadjadj, qui dirige les éditions Barzakh en Algérie, et qui a tenu à la délégation française un discours dont les adresses étaient importantes, et pas seulement parce qu’on ne les entend pas assez.
L’édition numérique est-elle une opportunité pour les pays du Sud ?
“Je représente les profanes dans cette assemblée de spécialiste”, rappelle Sofiane Hadjadj. “Nous, éditeurs méditerranéens, nous regardons les débats, les inquiétudes et les agitations de loin.” Mais les regarder de loin ne signifie pas ne pas s’y intéresser de près. Sofiane se souvient avoir entendu déjà il y a quelques années un “prêche” de Google qui, de passage par les pays du Maghreb, venait y rôder son discours libéral et libertaire, qui sous couvert de philanthropie, n’évoquait déjà que des réalités marchandes et économiques. Depuis l’eau à coulé. Google depuis a avancé, bien plus vite que les pays du Maghreb. La nécessité de comprendre les enjeux et les conséquences que la révolution numérique va avoir sur l’édition traditionnelle et sur les lecteurs n’en est que plus vive.

Image : une application pour lire le Coran développée par Batoul Apps, la start-up du développeur américain Ameir Al Zoubi.
Sofiane est membre de membre de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants, une association qui prône la bibliodiversité éditoriale et favorise l’édition solidaire. Cette association va d’ailleurs avoir, cette semaine, à Ouagadougou (Burkina Faso) où se tient la Foire internationale du livre, une première rencontre sur le sujet, notamment pour évoquer le lancement d’une étude sur l’opportunité de l’édition numérique pour les pays en développement.
“Il est difficile de regarder la question du numérique pour un éditeur profane, pour qui ces questions ne sont pas essentielles au quotidien. Mais ce qui semble secondaire pour l’instant, peut aller vite demain”, estime l’éditeur avec un doute dans la voix, le même qui agite l’édition mondiale… Qui n’est pas de savoir si la révolution numérique va avoir lieu (tout le monde en est persuadé), mais quand la bascule va réellement se produire.
Sofiane Hadjadj rappelle pourtant l’étendu de la fracture numérique qui sépare pour l’instant les pays du Sud des pays du Nord. Des pays du Sud qui ne forment pas pour autant un ensemble homogène : rien ne rapproche le Qatar du Burkina, ni en terme de connexion, d’équipement ou d’usage. Autant d’obstacles qui empêchent de regarder la question du numérique de la même façon. “Sur le plan éditorial également, nous ne parlons pas des mêmes réalités”, rappelle l’éditeur. Alors que le Maroc ou l’Algérie publient difficilement 4000 titres par an (contre quelque 55 000 par an en France), le différentiel (de 1 à 15) est encore incroyablement plus important en ce qui concerne le livre numérique. “Nous sommes durablement confrontés au manque structurel de production de savoir dans les pays en développement et à la surproduction des industries culturelles des pays développés.” Dans les pays en développement, l’individu cherche encore sa place sur le numérique.
En même temps, vue du Sud, le livre numérique semble intéressant pour sa légèreté, sa facilité d’accès, sa facilité de fabrication. Il apparaît même comme un remède miracle, car il demande des investissements bien moindres que la production d’ouvrages en papier. “Est-il pour autant un remède pour les pays en voie de développement ? Peut-il nous permettre d’espérer un rattrapage ?” Sofiane Hadjadj ne semble pas vraiment y croire. Les réalités économiques auxquelles il est confronté sont certainement trop lourdes pour laisser beaucoup d’espoirs.
La réalité du livre dans les pays du Maghreb est plutôt un échec
“Pour l’instant, les livres viennent du Nord et arrivent au Sud, avec un chemin compliqué de vente et de distribution. Ils suivent une chaîne longue, coûteuse, écologiquement et économiquement catastrophique.” Bien souvent, les éditeurs français pensent savoir se trouver une place sur les marchés francophones, et rechignent à céder des droits pour des zones linguistiques identiques. Pourtant, ils ne parviennent pas à pénétrer ces marchés. Leurs produits, même au format poche, n’ont pas des prix adaptés aux réalités du marché local, leurs distributeurs ne connaissent pas très bien ces micro-marchés locaux composés d’à peine une cinquantaine de librairies dignes de ce nom par pays, là où la France en compte 3000 (dont 800 de qualité).
Or, les cessions de droits permettent aux éditeurs du Sud de vivre, elles leur permettent de construire des éditions adaptées à leurs marchés comme l’explique très bien Layla Chaouni des éditions Le Fennec au Maroc, qui a lancé une superbe collection de livres de poche à 1 euro. Bien des écrivains méditerranéens édités en France sont ainsi inaccessibles à leurs publics d’origine parce que les éditeurs rechignent à céder les droits sur ces marchés qu’ils ne maîtrisent pourtant pas. Ils proposent des livres grands formats ou de poches à des prix allant de 10 à 30 euros : ce qui est inaccessible dans les pays où le revenu moyen tourne autour de 350 euros.
Certes, les éditeurs du Sud font le même constat : il ne semble pas y avoir de barrière psychologique par rapport au numérique. L’appétit et la fascination pour la technologie sont primordiaux dans les pays du Maghreb où deux tiers de la population à moins de 25 ans. “Le livre est plutôt un échec dans nos sociétés”, constatent avec une grande lucidité les éditeurs. Il n’est pas inscrit dans la vie quotidienne des gens. Le réseau de librairie est très limité et vendre deux mille exemplaires d’un livre est considéré comme un grand succès de ce côté de la méditerranée.
“Le problème c’est le manque d’appétence des jeunes pour la culture”, estime l’éditeur tunisien Wallid Soliman (blog) des éditions Walidoff. “Il faut aller les chercher. Trouver les livres qui les adressent.” Les jeunes sont donc très décomplexés : “Lire un livre papier ou un livre sur ordinateur, pour eux, c’est pareil !”
Pour autant les éditeurs ne sont pas idiots, ils savent bien qu’il faut regarder qui contrôle les tuyaux et là où ils s’arrêtent. Dans des pays où l’équipement individuel est inexistant, où les connexions sont souvent lentes et aléatoires, où seul le téléphone mobile semble s’être installé, quelles solutions sont accessibles ? Pour l’instant, les éditeurs du monde arabe les plus avancés sur le numérique sont les éditeurs libanais, qui forment le coeur de l’édition arabe, et les éditeurs de livres de propagandes religieuses.
“Les situations de déséquilibres se creusent. Or, le livre n’est pas que du domaine du marchand. C’est un bien culturel. Il ne doit pas répondre qu’à la loi de l’offre et la demande. Dans les pays méditerranéens, le livre circule mal. Or, ici, le livre est une question de survie au quotidien. Il est l’avenir des sociétés, de la civilisation arabe dans toute sa diversité”, insiste Sofiane Hadjadj.
L’accès d’abord… au risque du piratage ?
Le livre numérique est-il une solution pour combattre le différentiel des savoirs et des connaissances ? Et Sofiane de faire référence à la musique et au cinéma. “Il y a 20 à 30 ans, il y avait dans les pays du Maghreb un grand retard dans l’accès au divertissement, lié à des problèmes de diffusion. Le passage au numérique, via le CD et le DVD, a été une révolution extraordinaire : on s’est adapté, en retard, mais cela a été un outil de développement important. On a pu accéder à un Nouveau Monde culturel, via des supports légers, nouveaux, accessibles. Un lecteur DVD désormais cela coûte 30 euros. Un DVD, 1 euro. D’un coup, les populations ont eu le sentiment de participer de la marche du monde. Mais cela s’est fait à la condition du piratage : et tout cet apport est basé sur un piratage, largement consenti. Les Majors des industries culturelles savent très bien que leurs films, leurs musiques et leurs logiciels sont massivement piratés. Ils ont compris que c’était dans leur intérêt. Qu’ils n’allaient pas faire leur business ici ! Ils ont compris qu’ils ont intérêt à ce que cette culture se développe, de manière accessible, qu’elle touche les clients de demain, pour que leurs marchés soient assurés quand ces pays se développeront. Le débat sur le contrôle, ici, n’a pas lieu, même pour les producteurs de culture locaux.”
Avec un très faible déploiement du parc des ordinateurs personnels, des connexions internet très rares, des pratiques de lectures papier assez faibles… et une existence forte des pratiques de piratages des livres papiers, les éditeurs du Sud demeurent dubitatif face aux promesses de l’électronique. D’autant, qu’il y a une autre raison au piratage du livre numérique. Le paiement dématérialisé n’existe pas de ce côté-ci de la méditerranée. Comment parvenir à se rémunérer dans un marché atone et techniquement inexistant ?
Des questions similaires, des réponses différentes
Il est intéressant de constater que les questions que nous adressent les éditeurs du Sud sont les mêmes que celles que se posent les éditeurs du Nord. Quels contenus vont-ils pouvoir proposer ? Vont-ils pouvoir faire exister les leurs dans une culture toujours plus Mainstream, comme l’explique le livre éponyme de Frédéric Martel ?
Qui diffuse et qui vend ? La question de la constitution d’une chaîne de diffusion numérique est aussi importante des deux côtés de la méditerranée, chacun comprenant bien que sans elle, rien n’est possible, et que celles que proposent Apple, Amazon ou Google, ne sont peut-être pas des solutions sans conséquences pour la chaîne du livre et la diversité culturelle.
La question de l’accès est bien sûr essentielle. Celle de la démocratisation des supports, celle des possibilités de connexion ou de modes de paiement bien sûr. Mais peut-être plus encore, celle de l’accès à la culture. Au Nord comme au Sud, ces outils s’adressent d’abord à ceux qui lisent, à ceux qui ont le plus de moyens économiques ou culturels. Qui s’adressera aux autres ?
Quant aux questions de paiements et de modèles économiques, elles demeurent entières, même si la différence des conditions économiques conduira à ne pas apporter les mêmes réponses. Construire des offres sur de la téléphonie mobile traditionnelle par exemple n’intéresse pas beaucoup les éditeurs occidentaux, même si le parc de téléphones mobiles est de loin le premier parc de terminaux électroniques au monde, loin devant la radio, la télévision, l’ordinateur voire même les téléphones de seconde génération ou les outils dédiés, cibles de toutes les attentions.
Ce qui est certain, c’est que la révolution du téléphone portable est palpable. Elle est technologique et civilisationnelle, conclut Sofiane Hadjadj. “Le téléphone mobile a fait devenir les gens des individus”. C’est également ce que la culture et la connaissance proposent, mais d’une toute autre manière. Encore faut-il nous défier que demain, la communication prenne le pas sur la culture pour libérer l’homme.

![]()
 Je boude le Salon du livre de Paris, mais pas celui de Genève qui se tiendra du 29 avril au 3 mai. Je participe au laboratoire des nouvelles lectures, un forum pour réfléchir à l’avenir de la lecture et qui propose un concours autour des nouvelles formes de lectures auxquels tout un chacun est invité à participer (5000 FCH de prix). Dans ce cadre, j’animerai avec Frédéric Kaplan une journée de formation et d’ateliers lundi 2 mai (130 places maximum).
Je boude le Salon du livre de Paris, mais pas celui de Genève qui se tiendra du 29 avril au 3 mai. Je participe au laboratoire des nouvelles lectures, un forum pour réfléchir à l’avenir de la lecture et qui propose un concours autour des nouvelles formes de lectures auxquels tout un chacun est invité à participer (5000 FCH de prix). Dans ce cadre, j’animerai avec Frédéric Kaplan une journée de formation et d’ateliers lundi 2 mai (130 places maximum). 



 Souvent, on cherche un livre par le nom de son auteur et le titre du livre. Ce qui n’est pas idéal pour parvenir jusqu’à lui, tant les résultats vont être pollués par des centaines de références (sites de médias ayant évoqué l’auteur, sites de commerce en ligne…).
Souvent, on cherche un livre par le nom de son auteur et le titre du livre. Ce qui n’est pas idéal pour parvenir jusqu’à lui, tant les résultats vont être pollués par des centaines de références (sites de médias ayant évoqué l’auteur, sites de commerce en ligne…). 
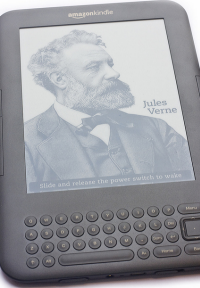


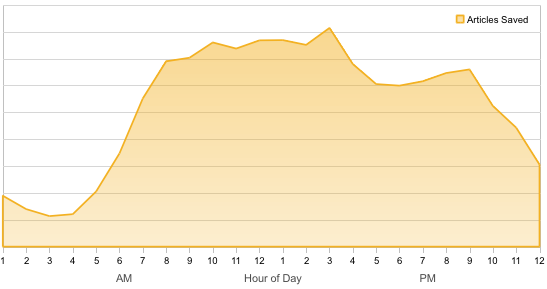
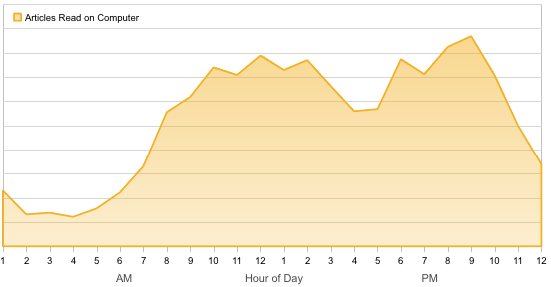









 La seconde impression de cette première visite donne le sentiment que cette ouverture a été précipitée. Sur la home de la boutique, trois des liens accessibles : la liste des bestsellers du New York Times, celle des livres de Noël et des meilleurs livres de 2010 conduisent à une page d’erreur. J’ai tendance à penser que c’est peut-être lié à ma connexion (pas sûr que tous ceux qui ont eu accès à la boutique aient eu cette erreur). Mais la perspective d’être absent des ventes de Noël a visiblement joué.
La seconde impression de cette première visite donne le sentiment que cette ouverture a été précipitée. Sur la home de la boutique, trois des liens accessibles : la liste des bestsellers du New York Times, celle des livres de Noël et des meilleurs livres de 2010 conduisent à une page d’erreur. J’ai tendance à penser que c’est peut-être lié à ma connexion (pas sûr que tous ceux qui ont eu accès à la boutique aient eu cette erreur). Mais la perspective d’être absent des ventes de Noël a visiblement joué. La quatrième impression est que l’intégration de la boutique rend le moteur de recherche de livres d’un coup déséquilibré. Comme on le voit dans cette capture d’écran, d’un coup une recherche donne la part belle aux livres de Google sur les livres proposés par la concurrence. L’équité, qui avait paru être un gage du projet Google Books Search, puisqu’après discussions, Google avait incorporé de nombreux libraires tiers à son moteur, est rompue. Google se donne un avantage commercial. “Le Léviathan Google, qui ne se voulait que le relais de toute l’information, de toutes les connaissances de l’univers”, comme le dit Ariel Kyrou dans
La quatrième impression est que l’intégration de la boutique rend le moteur de recherche de livres d’un coup déséquilibré. Comme on le voit dans cette capture d’écran, d’un coup une recherche donne la part belle aux livres de Google sur les livres proposés par la concurrence. L’équité, qui avait paru être un gage du projet Google Books Search, puisqu’après discussions, Google avait incorporé de nombreux libraires tiers à son moteur, est rompue. Google se donne un avantage commercial. “Le Léviathan Google, qui ne se voulait que le relais de toute l’information, de toutes les connaissances de l’univers”, comme le dit Ariel Kyrou dans 
 .
.


 Voilà longtemps que LT développe des aides contextuelles assez remarquables (la basse de “connaissances communes”) qui permet de déclarer les récompenses que les livres ont reçues, mais également des personnages, des lieux, etc. Regardez un exemple très simple,
Voilà longtemps que LT développe des aides contextuelles assez remarquables (la basse de “connaissances communes”) qui permet de déclarer les récompenses que les livres ont reçues, mais également des personnages, des lieux, etc. Regardez un exemple très simple, 



 Consultez le ReadWriteBook pour feuilleter quelques textes essentiels pour comprendre l'avenir du livre.
Consultez le ReadWriteBook pour feuilleter quelques textes essentiels pour comprendre l'avenir du livre. 








